• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris • 01 42 65 08 87 • dlf.paris@club-internet.fr •

DLF, n° 291
 LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITÉ PAR LE LANGAGE. UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE Sous la direction de Marcienne Martin et Sylvain Beaupré
LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITÉ PAR LE LANGAGE. UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE Sous la direction de Marcienne Martin et Sylvain Beaupré L’Harmattan, « Nomino ergo sum », 2023, 246 pages, 27 €, version numérique 20,99 €
Dans cette publication, treize spécialistes présentent dix études, qui montrent la variété prenant sa source de différents noms donnés à l’être humain. Identité personnelle, identité inscrite dans le passé et le présent, identité professionnelle et identité collective sont les thèmes analysés successivement. Dans le cadre de cette étude, il est montré que l’identité, dans un premier temps, prend sa source de l’observation de son environnement, procédure dérivée de la pensée analogique, laquelle met en relation ce qui est déjà dans la mémoire de l’observateur et l’objet observé dont certains paramètres, comme la forme, la couleur, ou autres, réactivent la mémorisation de telle observation possédant des caractéristiques similaires. Il en est ainsi de l’observation de la chevelure brune de tel sujet social à partir de laquelle son identité au niveau de son nom de famille a pris sa source : Lebrun. En fonction de l’évolution sociohistorique, l’inscription identitaire peut se transformer, ce qui renvoie à l’histoire de la population canadienne d’origine française, qui s’inscrit, à la fois, dans une manière de continuité au niveau de leurs noms, puisque les migrants ont transmis leur nom de famille originaire de France, et dans le cadre d’un changement de noms, certains ont pris des surnoms qui se sont substitués aux noms de famille existants. Si le choix d’une profession peut se faire par intérêt ou par nécessité, son appartenance donne au travailleur des valeurs qui lui sont spécifiques. Ainsi, dans le secteur médical, l’empathie et l’honnêteté sont prédominantes. Quant à l’identité collective, elle s’inscrit dans un système en relation avec l’appartenance à telle culture et à tel pays où certaines valeurs sont les éléments de base.
 GUIDE DES 100 EXPRESSIONS FAVORITES DE NOS GRANDS-MÈRES de Laurence Caracalla, illustrations de Pascal Gauffre
GUIDE DES 100 EXPRESSIONS FAVORITES DE NOS GRANDS-MÈRES de Laurence Caracalla, illustrations de Pascal Gauffre Le Figaro littéraire, 2023, 148 pages, 9,90 €, liseuse 12,99 €
Laurence Caracalla exhume des formules surannées qui affleurent pourtant dans nos mémoires. Elles sont imagées et pittoresques et leur origine est parfois incertaine. Ainsi l’énigmatique « et tout le saint-frusquin » qui marque la fin d’une énumération. Le juron « nom d’un petit bonhomme ! » est plus transparent en faisant référence aux statuettes représentant le Christ. « Ça fait (ou ça ne fait pas) la rue Michel » est une formule des cochers de fiacre qui renvoie à la rue Michel-le-Comte. « À tout(e) berzingue » qui provient du patois picard, était encore utilisée récemment. « Faire du gringue » a été supplantée par draguer ou brancher, « Trifouillis-les-Oies » par Pétaouchnock. La mystérieuse « Au diable vauvert » remonte au Moyen Âge, sans que l’on connaisse Vauvert. Gardons pour la fin l’insolite « petit Jésus en culotte de velours », qui s’utilise pour qualifier un bon vin. Pierre Gusdorf
 100 MOTS & EXPRESSIONS EMPLOYÉS À MAUVAIS ESCIENT de Julien Soulié
100 MOTS & EXPRESSIONS EMPLOYÉS À MAUVAIS ESCIENT de Julien Soulié Le Figaro littéraire, 2022, 137 pages, 9,90 €
Trouver le bon mot au moment opportun n’est pas toujours facile. Ce livre aborde les erreurs ou maladresses que l’on commet fréquemment : contresens, faux-sens, imprécisions, confusions, barbarismes… Un renoncement n’est pas une renonciation. Incongru ne correspond pas à saugrenu. On sable le champagne après l’avoir sabré. L’alternative n’est pas une solution de remplacement. Une décade ne compte que dix jours...L’auteur mentionne des pléonasmes syntaxiques et lexicaux parfois insoupçonnés et passés hélas dans le langage courant ; il aborde enfin la délicate question des ruptures de construction qui malmènent la syntaxe et que l’on nomme « anacoluthes », ainsi : « après avoir fini d’écrire mon manuscrit, mon éditeur m’a félicité ». Pierre Gusdorf
 JEAN DE LA FONTAINE, PORTRAIT D'UN POMMIER EN FLEUR de Jean-Michel Delacomptée
JEAN DE LA FONTAINE, PORTRAIT D'UN POMMIER EN FLEUR de Jean-Michel Delacomptée Le Cherche midi, 2023, 192 pages, 18,50 €, liseuse 12,99 €
Voilà un regard nouveau sur notre célèbre Jean de La Fontaine qui faisait fleurir des fables comme les pommiers font éclore des pommes.
D’humeur morose qu’on qualifierait peut-être aujourd’hui de comportement autistique, peu soucieux de son apparence et ayant toujours tiré le diable par la queue, il vivait dans un monde imaginaire qui n’appartenait qu’à lui, travaillait sans relâche et reprisait ses écrits comme nos grand-mères reprisaient des bas. Soucieux de plaire à un large public, il a su s’adapter aux goûts de son époque et moderniser les thèmes de ses fables puisés dans l’Antiquité. À l’heure où notre langue connaît divers soubresauts, « lire, apprendre et écouter les fables de La Fontaine, c’est... une impérissable manière d’entretenir la flamme » du « langage des dieux » cher à La Fontaine. Bénédicte Katlama
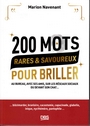 200 MOTS RARES ET SAVOUREUX POUR BRILLER de Marion Navenant
200 MOTS RARES ET SAVOUREUX POUR BRILLER de Marion Navenant De Boeck Supérieur, 2023, 208 p., 14,90 € , liseuse 11,99 €
Dès la première de couverture, Marion Navenant précise avec qui et où briller : « au bureau, avec ses amis, sur les réseaux sociaux ou devant son chat... ». L’autrice a relevé 200 mots menacés de disparition ou quasiment disparus, ou en tout cas devenus très rares car les prononcer présente le risque de les écorcher en raison de leur composition. Ces mots dont elle donne l’origine, l’évolution et même parfois les remplaçants argotiques, sont répartis en douze rubriques ou circonstances dont certaines sont déjà nommées et auxquelles s’ajoutent : vacances, restaurant, cabinet médical, voiture, présence d’enfants, rendez-vous amoureux. Il y en a beaucoup que vous connaissez mais certains sont particulièrement surprenants comme nycthémère (alternance d’un jour et d’une nuit correspondant à un cycle biologique de 24 heures) ou ailurophiles qui désigne simplement « les mordus de félidés », autrement dit « qui aiment les chats ». Ce recueil n’invite ni à la vanité ni à la pédanterie, mais plutôt à l’emploi du mot juste et à la pratique de l’eutrapélie, cette vertu essentielle qui consiste à cultiver un esprit léger et à prendre plaisir dans la vie même au milieu de tâches sérieuses. Peut-être aimeriezvous allonger cette liste de mots rares. Parmi les noms de collectionneurs cités, il en manque un. C’est le tyrosémiophile, celui qui collectionne les étiquettes de fromages. Jacques Dhaussy
 LE LIVRE D’UNE LANGUE sous la direction de Barbara Cassin, de l’Académie française
LE LIVRE D’UNE LANGUE sous la direction de Barbara Cassin, de l’Académie française Éditions du patrimoine, 2023, 312 p., 42 €
Août 1539. Au relais de chasse dit « Mon plaisir «, à Villers-Cotterêts, le roi François Ier signe une ordonnance imposant l’usage du français comme langue d’État dans les actes de l’administration et de la justice. Cinq siècles plus tard, c’est le même édifice, restauré dans toute sa splendeur qui devient la Cité internationale de la langue française. Davantage qu’un musée, car ouvert sur les alentours, la région, point de rencontre pour les habitants et les touristes, les enfants des écoles, les étudiants, les passionnés de linguistique et tous les curieux qui veulent savoir comment il est possible d’ « exposer une langue ».
Internationale ? Oui, au sens où le français est émancipé de longue date de son territoire d’origine, parlé par environ 321 millions de personnes dans le monde francophone (le célèbre italien Casanova affirmant être le premier d’entre eux !).
Le Livre d’une langue éclaire, grâce à de nombreuses photos, à quel point l’existence de ce château Renaissance, décoré de fleurs de lys, chérubins, frises sculptées et salamandres, relève du miracle. Devenu bien national en 1793, le domaine est passé brutalement de la grandeur à la déchéance : successivement caserne, dépôt de mendicité, hospice pour indigents et infirmes, maison de retraite jusqu’en 2014.
Ce très beau recueil relate, sur plus de trois cents pages, les tribulations du français à travers l’Histoire, les incessants mouvements d’import-export avec d’autres langues, la fabrique des mots, la survivance des patois et des parlers régionaux, et surtout le développement d’une langue-monde, comme il en existe moins d’une dizaine sur les 7 000 idiomes parlés sur la planète. Monika Romani
Site internet à visiter
CITATIONS VÉRIFIÉES (https://citationsverifiees.fr)
Tristan Grellet, qui fut un de mes nombreux élèves et stagiaires correcteurs, propose un site remarquable consacré à la vérification de la fiabilité des citations reprises çà et là...
La rigueur exemplaire de l’auteur, le soin avec lequel il mène ses recherches, garantissent la qualité et la sûreté des informations mises ainsi à la disposition des internautes ! Quand il y a doute, Tristan l’expose en toute honnêteté. Bravo ! Jean-Pierre Colignon
Signalons aussi :
- OÙ EST LA FAUTE ? TESTEZ ET AMÉLIOREZ VOTRE NIVEAU DE FRANÇAIS. TOME 2, de Jean-Pierre Colignon (ediSens, « En français dans le texte », 2024, 240 p., 16 €).
- 100 MOTS ET EXPRESSIONS DE LA LANGUE FRANÇAISE QUI ONT CONQUIS LE MONDE, de Jean Pruvost (Le Figaro littéraire, 2023, 146 p., 9,90 €).
- DICTIONNAIRE DES VERBES DU FRANÇAIS ACTUEL. CONSTRUCTIONS, EMPLOIS, SYNONYMES, de Ligia Stela Florea et Catherine Fuchs, avec la collaboration de Frédérique Mélanie-Becquet (Ophrys, « L’essentiel français », 2023, nouvelle édition revue et corrigée, 284 p., 19,95 €).
- LE JARDIN DES MOTS. DICTIONNAIRE AMUSANT ET SAVANT DES SENS FIGURÉS, de Roland Eluerd (Aux Feuillantines, 2024, 388 p., 29 €).
- 250 DESSINS POUR NE PLUS FAIRE DE FAUTES, de Sandrine Campese (Le Figaro Éditions, 2024, 400 p., 24 €).
- LE FRANÇAIS À LA DÉRIVE, d’Antoine Minaud [†](Yellow Concept, 2019, 166 p., 14 €), s’adresser à Mme Minaud : antoine.minaud@orange.fr
- Aux Éditions Lambert-Lucas :
• REPRÉSENTATIONS ET USAGES DE LA LANGUE FRANÇAISE EN ALGÉRIE (SYNTHÈSE 2000-2020), de Matthieu Marchadour et Philippe Blanchet (2023, 176 p., 20 €).
• ORGANISATIONS ET ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUES DU FLE/FLS, sous la direction de Philippe Blanchet et Patrick Chardenet (2023, 216 p., 27 €).
* * *
 Nos adhérents publient
Nos adhérents publient
- Trissotin, Tartuffe, Torquemada : la conjuration des trois « T ». Jalons d’un parcours rebelle 1956-2022 (France Univers, 2023, 216 p., 18 €). Qu’ils portent sur la politique, la langue, les arts..., ces textes polémiques de Michel Mourlet ont comme « préoccupation commune de mettre la culture au centre des débats qui agitent et divisent le monde occidental ».
- Le nouvel essai de Quentin Debray, Sophie de Ségur, George Sand, Jules Renard et autres lectures d’enfance, est une approche psychologique et littéraire de l’enfance au XIXe siècle (Orizons, « Profils d’un classique », 2023, 136 p, 18 €).
- Dans le numéro 1269 du bimensuel Royaliste, Marc Favre d’Échallens analyse les nuances et ambiguïtés du discours prononcé par le président Emmanuel Macron le 4 janvier lors de l’inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts.
- À voir sur le site de DLF, concoctée par Bernard Fripiat et son équipe, la nouvelle séquence d’orthogaff.com : « Sans faute(s), pourquoi ? »
- Pendant plus de trente ans, Hélène Tirole a interrogé des bouquinistes. Dans Quais des livres. Des bords de Seine au Saint-Laurent (Éditions Unicité, 2024, 158 p., 18 €), elle les présente, d’hier à aujourd’hui, au fil d’extraits de poèmes, chansons et autres textes de nombreux écrivains. Cet ouvrage est préfacé par Jean Pruvost.
- Quelle langue parlent les écrivains ? se demande Lise Gauvin dans son nouvel essai : Des littératures de l’intranquillité (Karthala, 2023, 236 p., 20 €), en étudiant les oeuvres d’auteurs francophones, tels qu’Assia Djebar, Ahmadou Kourouma, Patrick Chamoiseau...
- À lire, entre autres, dans la belle revue Art et Poésie de Touraine (n° 255), les poèmes sur Noël, de Nicole Lartigue et son article « Égyptologie : Ramsès II à Paris ».
- Outre l’éditorial, Alain
Ripaux, président de Francophonie
force oblige, signe
plusieurs articles de sa Revue
francophone d’information
(n° 9) :
« La Réunion », « Les actualités francophones » et « La vie de l’association FFO défend la langue française et la francophonie ». - « Le trottoir ? », tel est le
titre de l’article amusant et
très documenté de Philippe
Deniard, dans Le Nouveau
Dévorant,
revue littéraire des cheminots (n° 315).
• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris •